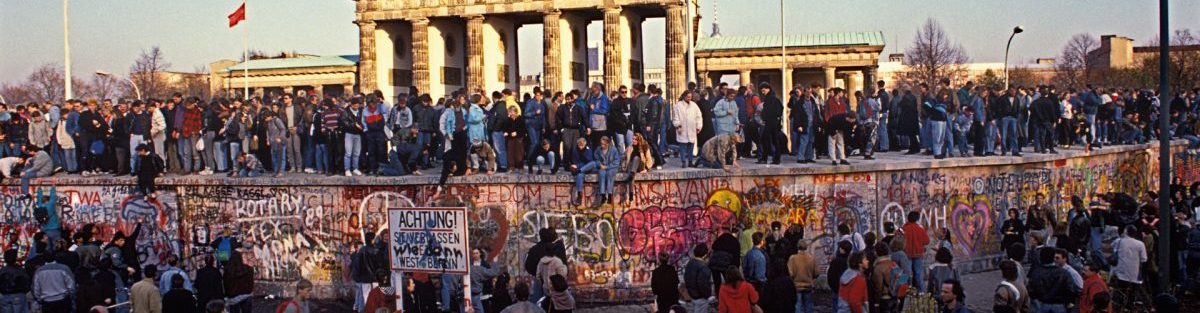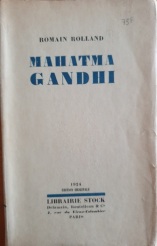 L’ouvrage de Romain Rolland, Mahatma Gandhi, paru au début de l’année 1924, est le premier en Europe à traiter de la pensée et du combat de Mohandas Karamchand Gandhi. Celui-ci, auréolé de ses premières victoires obtenues en Afrique du Sud entre 1906 et 1914 par les méthodes de l’action non-violente, est devenu, depuis son retour en Inde en 1915, le leader du mouvement pour l’indépendance de l’Inde. A partir de 1920, Romain Rolland se met à l’écoute de celui que le poète Tagore a surnommé Mahatma, « la grande âme ».
L’ouvrage de Romain Rolland, Mahatma Gandhi, paru au début de l’année 1924, est le premier en Europe à traiter de la pensée et du combat de Mohandas Karamchand Gandhi. Celui-ci, auréolé de ses premières victoires obtenues en Afrique du Sud entre 1906 et 1914 par les méthodes de l’action non-violente, est devenu, depuis son retour en Inde en 1915, le leader du mouvement pour l’indépendance de l’Inde. A partir de 1920, Romain Rolland se met à l’écoute de celui que le poète Tagore a surnommé Mahatma, « la grande âme ».
Lire la suite
Archives du mot-clé Non-violence
Entre guerre et paix, la voie de la non-violence de Alain Refalo
 La guerre en Ukraine ravive les tensions internationales et les risques de guerre mondiale, à l’heure où la crise climatique hypothèque notre avenir. Pendant ce temps, la France augmente considérablement son budget militaire, amplifie sa production d’armements et contribue à la militarisation de l’Europe.
La guerre en Ukraine ravive les tensions internationales et les risques de guerre mondiale, à l’heure où la crise climatique hypothèque notre avenir. Pendant ce temps, la France augmente considérablement son budget militaire, amplifie sa production d’armements et contribue à la militarisation de l’Europe.
Dans ce contexte belliciste, je souhaite faire entendre une voix non-violente pour tracer une autre voie, entre culture de guerre et inaction « pacifiste ». Ma conviction est que pour faire la paix, il faut la préparer avec les outils de la non-violence et les méthodes de la résistance civile. Autant de chantiers que je m’efforce de défricher et de défendre dans ces chroniques écrites dans le feu de l’actualité. Lire la suite
La radicalité de la non-violence
On oppose souvent, dans les luttes, la radicalité de la violence à la mollesse que représenterait la non-violence. Alors, en quoi la non-violence est-elle radicale ?
Subversive non-violence ! Chroniques pour réenchanter nos luttes et nos vies
 La non-violence, en tant qu’utopie pratique, offre la possibilité d’une véritable alternative, plus exigeante, mais pas moins réaliste, entre la violence et l’inaction.
La non-violence, en tant qu’utopie pratique, offre la possibilité d’une véritable alternative, plus exigeante, mais pas moins réaliste, entre la violence et l’inaction.
Dans ces chroniques, Alain Refalo confronte l’idéal de la non-violence aux réalités de notre temps. A l’heure où la guerre revient en Europe, elles proposent une petite lueur d’espérance dans un monde toujours malade de la violence. Assurément, elles nous invitent à réenchanter notre luttes et nos vies.
Lire la suite
Alain Refalo
21 décembre 2021
Jean-Marie Muller, penseur de la non-violence
Notre ami, Jean-Marie Muller, a quitté ce monde, le 18 décembre, à l’âge de 82 ans. Il y a cinq ans, cinquante ans après sa première conférence donnée à Orléans le 10 octobre 1966, nous présentions son parcours de militant et d’écrivain : « 50 ans d’engagements au service de la non-violence ». Aujourd’hui, son oeuvre considérable reste à découvrir ou à redécouvrir. Jean-Marie Muller, dans les quelques 40 ouvrages qu’il a publiés, a pensé la non-violence dans toute ses dimensions et toute sa complexité afin d’une part d’éclaircir tous les malentendus qu’elle évoque encore, et d’autre part pour nous inviter à faire l’option existentielle de la non-violence, en tant que sagesse et méthode d’action. Nous présentons ici quelques éléments de sa contribution exceptionnelle à la compréhension réfléchie de la non-violence.
Lire la suiteL’idéal de la non-violence revisité par Judith Butler
 Judith Butler (1956 – ) est une philosophe américaine, connue dans le monde entier pour ses travaux sur le genre. Elle est professeur à l’université Berkeley depuis 1993. Depuis plusieurs années, elle développe une réflexion qui vise à renouveler l’idéal de la non-violence. Dans son nouvel ouvrage La force de la non-violence : une obligation éthico-politique (édité en France par Fayard), elle expose sa vision éthique et politique de la non-violence et « propose de constituer la non-violence comme nouvel imaginaire politique ». Nous venons de le lire.
Judith Butler (1956 – ) est une philosophe américaine, connue dans le monde entier pour ses travaux sur le genre. Elle est professeur à l’université Berkeley depuis 1993. Depuis plusieurs années, elle développe une réflexion qui vise à renouveler l’idéal de la non-violence. Dans son nouvel ouvrage La force de la non-violence : une obligation éthico-politique (édité en France par Fayard), elle expose sa vision éthique et politique de la non-violence et « propose de constituer la non-violence comme nouvel imaginaire politique ». Nous venons de le lire.
Lire la suite
Aux sources de la non-violence : l’ahimsa

Le 2 octobre (jour de la naissance de Gandhi) est la journée internationale de la non-violence. A l’approche de cette date décrétée par l’ONU, il m’a paru utile de rappeler que l’une des sources de la philosophie de la non-violence se trouve dans l’ahimsa qui est un terme sanskrit employé dans la littérature jaïniste, hindouiste et bouddhique. C’est d’ailleurs très probablement dans le jaïnisme que le concept d’ahimsa a émergé et s’est développé jusqu’à influencer d’autres spiritualités comme le bouddhisme et l’hindouisme. Essayons de clarifier le sens de ce terme que Gandhi traduira en anglais par « non-violence ».
La violence détruit le mouvement social
 Il est temps d’ouvrir les yeux et de dénoncer ce qui ne peut être justifié. Encore une fois, lors d’une manifestation légitime qui avait vocation à être pacifique afin que ses slogans soient bien entendus par l’opinion publique et par le pouvoir d’Etat, une minorité a détruit le potentiel revendicatif exprimé par les manifestants. Samedi 5 décembre, comme le samedi précédent, la manifestation contre la loi de sécurité globale a été détournée de son sens, elle a été pourrie de l’intérieur par une minorité d’irresponsables, qu’ils se nomment blackblocs ou autres, peu importe. L’heure n’est plus à l’excuse, car il n’y en a pas à l’endroit de ceux qui n’ont rien à voir avec le mouvement social. Ces gens-là, disons-le sans détour, avant d’être des ennemis (illusoires) de l’Etat, sont d’abord des ennemis réels du mouvement social. Lire la suite
Il est temps d’ouvrir les yeux et de dénoncer ce qui ne peut être justifié. Encore une fois, lors d’une manifestation légitime qui avait vocation à être pacifique afin que ses slogans soient bien entendus par l’opinion publique et par le pouvoir d’Etat, une minorité a détruit le potentiel revendicatif exprimé par les manifestants. Samedi 5 décembre, comme le samedi précédent, la manifestation contre la loi de sécurité globale a été détournée de son sens, elle a été pourrie de l’intérieur par une minorité d’irresponsables, qu’ils se nomment blackblocs ou autres, peu importe. L’heure n’est plus à l’excuse, car il n’y en a pas à l’endroit de ceux qui n’ont rien à voir avec le mouvement social. Ces gens-là, disons-le sans détour, avant d’être des ennemis (illusoires) de l’Etat, sont d’abord des ennemis réels du mouvement social. Lire la suite
La non-violence : une nouvelle définition
 Cette nouvelle définition de la non-violence sera publiée prochainement (début 2021) dans le Dictionnaire d’anthropologie prospective, publié par l’éditeur Vrin. Je l’ai rédigée dans le cadre de mes recherches lexicologiques et sémantiques sur le mot “non-violence” qui devraient aboutir à la publication d’un ouvrage, avec le concours de l’Institut de recherche sur la Résolution Non-violente des Conflits (IRNC). Les références entre parenthèses renvoient à la bibliographie qui suit l’article. Comme toute définition, celle-ci est bien entendu sujette au débat et à l’échange constructif. Lire la suite
Cette nouvelle définition de la non-violence sera publiée prochainement (début 2021) dans le Dictionnaire d’anthropologie prospective, publié par l’éditeur Vrin. Je l’ai rédigée dans le cadre de mes recherches lexicologiques et sémantiques sur le mot “non-violence” qui devraient aboutir à la publication d’un ouvrage, avec le concours de l’Institut de recherche sur la Résolution Non-violente des Conflits (IRNC). Les références entre parenthèses renvoient à la bibliographie qui suit l’article. Comme toute définition, celle-ci est bien entendu sujette au débat et à l’échange constructif. Lire la suite
Non-violence et décroissance : essai de convergence en quelques mots
 Tout comme la décroissance, la non-violence est un processus, un chemin et non pas une finalité, encore moins un dogme. Les deux mots « non-violence » et « décroissance », que nous associons volontiers, sont des termes « négatifs » qui existent par ce à quoi ils s’opposent directement : la violence et la croissance. Ils permettent de nommer clairement la démarche de rupture engagée avec l’ordre établi, qu’il soit politique ou économique. Les deux mots expriment la décision et la volonté de sortir des logiques oppressives et mortifères qui fondent les systèmes dominants. Lire la suite
Tout comme la décroissance, la non-violence est un processus, un chemin et non pas une finalité, encore moins un dogme. Les deux mots « non-violence » et « décroissance », que nous associons volontiers, sont des termes « négatifs » qui existent par ce à quoi ils s’opposent directement : la violence et la croissance. Ils permettent de nommer clairement la démarche de rupture engagée avec l’ordre établi, qu’il soit politique ou économique. Les deux mots expriment la décision et la volonté de sortir des logiques oppressives et mortifères qui fondent les systèmes dominants. Lire la suite